Images et textes vus récemment (avec beaucoup trop de morts)
L’artiste américain Claes Oldenburg s’est éteint lundi, à 93 ans. Il était connu pour ses «monuments colossaux», d’immense sculptures répliquant des objets du quotidiens, comme sa «Bicyclette ensevelie» à Paris.
publié le 19 juillet 2022 à 14h32 dans Libération
Sa carrière a débuté dans les rues
de New York où il déambule, chargé de répliques en tissu ou en papier mâché de
tubes de dentifrice ou de cornets de glace surdimensionnés. Et c’est dans la
rue aussi, sur les places publiques, que ce pionnier du pop art a gagné une
immense popularité, en installant, dans l’espace public et de par le monde, ses
sculptures géantes – ainsi, à Paris, sa Bicyclette ensevelie s’allonge
dans le parc de la Villette, à Paris, depuis 1990, tandis qu’à San Francisco,
c’est l’arc de Cupidon (Cupid’s Span) qui reste bandé avec sa
flèche pointée vers la terre depuis vingt ans. Claes Oldenburg est mort le
lundi 18 juillet, à l’âge de 93 ans, quelques années après son épouse, Coosje
Van Bruggen, avec qui, depuis 1977, il
réalisait ces «monuments colossaux», à la
taille gargantuesque et à l’esprit volontiers grotesque, facétieux, enfantin.
Il renâclait à napper ses œuvres d’une patte conceptuelle, expliquant dès 1966
: «Mes théories ne sont pas originales, ma fabrication l’est, et mon
originalité repose sur ma sensualité et mon imagination, bien plutôt que mon
intelligence.»
Mollesse et vulnérabilité
Né en 1929 en Suède d’un père
diplomate, il grandit et étudie l’art et la littérature à Chicago, qu’il quitte
au seuil des années 60 pour New York. Il s’y fait d’emblée remarquer en ouvrant
un magasin – The Store, rempli de sculptures faites de bric et
de broc qui se mêlent indifféremment à des objets courants et à des matériaux
divers et variés. L’art, la vie, la marchandise au même rayon : l’idée n’est
pas tant ironique (se défier de la société de consommation) qu’une manière
presque duchampienne de déplacer l’espace de l’art et de sa création (la
boutique est aussi son atelier). Les sculptures prennent par ailleurs comme
modèle les objets de tous les jours et, de préférence, pas les plus reluisants,
mais pas non plus les moins prisés : mégots de cigarette, lingerie ou
hamburgers. Lesquels, entre les mains d’Oldenburg, ne sont jamais exactement
fidèles à leurs modèles réels.
En
modifiant exagérément leur taille, certes, mais aussi leur consistance,
Oldenburg les fictionnalise eux et tout l’environnement dans lequel il les
expose. C’est sa contribution à l’histoire de la sculpture, dont on attend
traditionnellement qu’elle soit dure et stable. Qu’elle se tienne fièrement
droite et bien en forme. Au contraire, celles d’Oldenburg, en plastique coloré,
vont faire des plis, s’affaisser, se débiner. La sensualité dont l’artiste se
fit fort tient à ça : à ce que certaines de ses pièces affichent leur mollesse,
et donc aussi leur vulnérabilité. Dès 1969, le Moma de New York a perçu cette
innovation majeure dans l’histoire de l’art, consacrant une rétrospective à
l’artiste, dont la carrière n’avait depuis connu aucun temps mort. Mis à part
quand même, celui du décès de sa femme et cocréatrice : depuis 2009, Oldenburg
ne livra qu’un seul nouvel ensemble d’œuvres.
_______________________________________________



















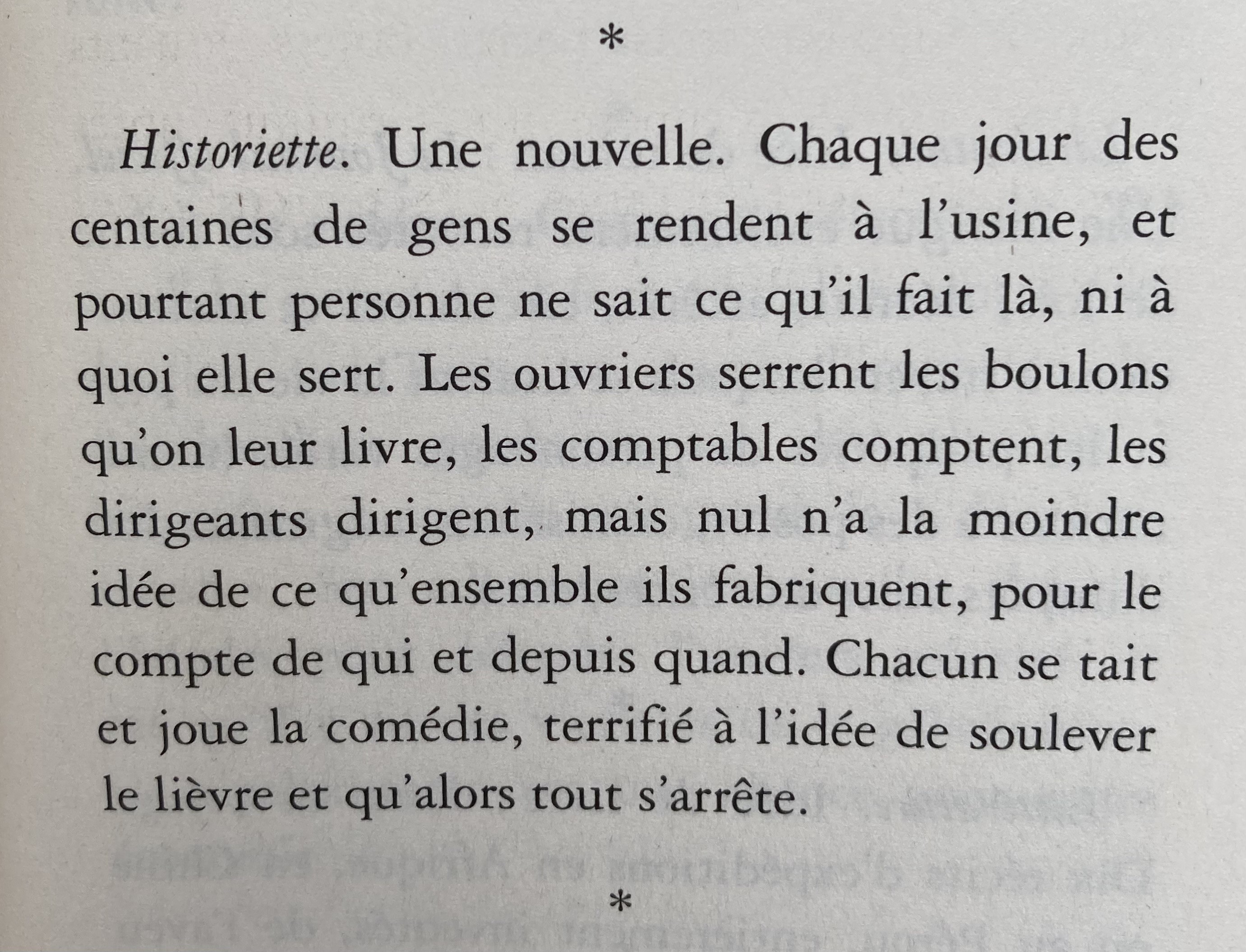




































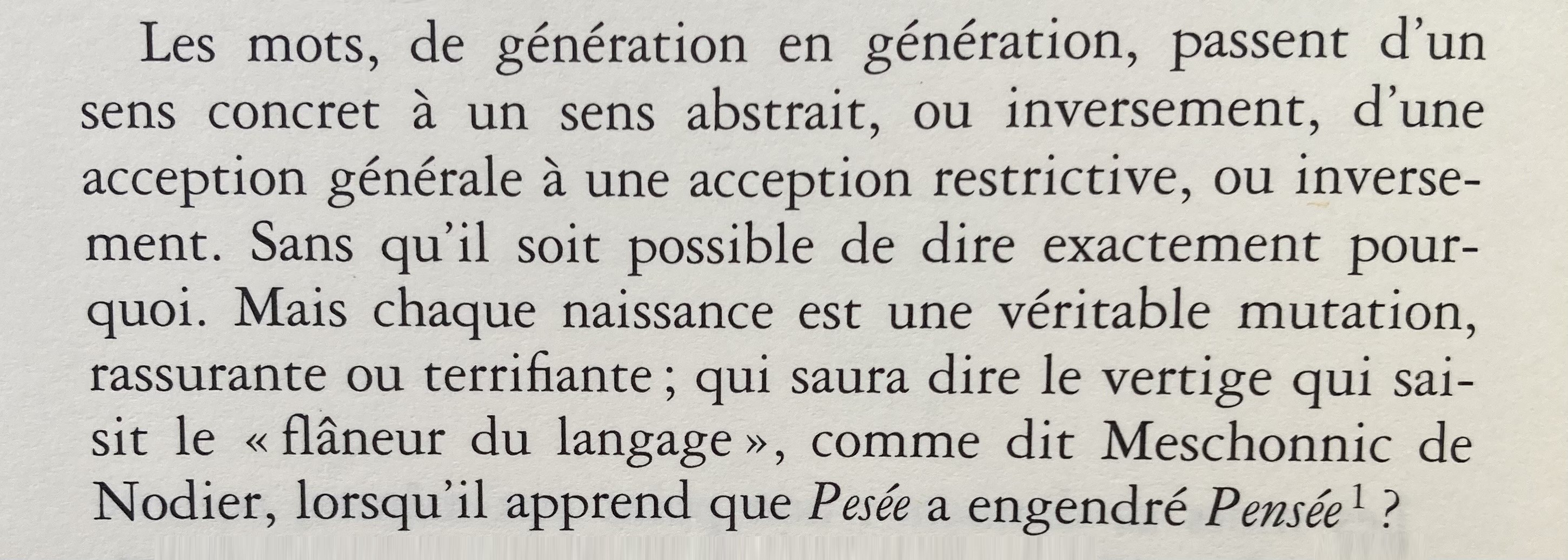





























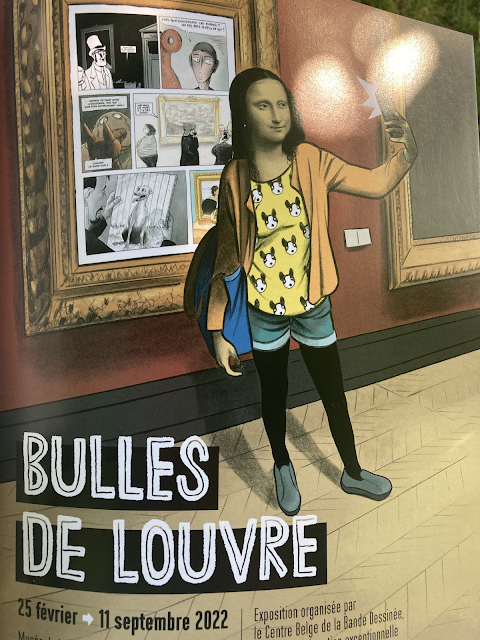

.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)





























































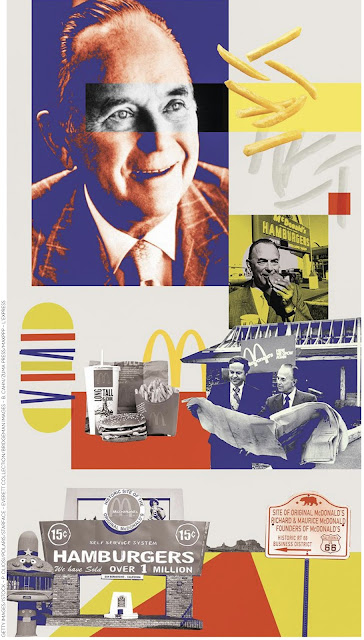















Commentaires
Enregistrer un commentaire